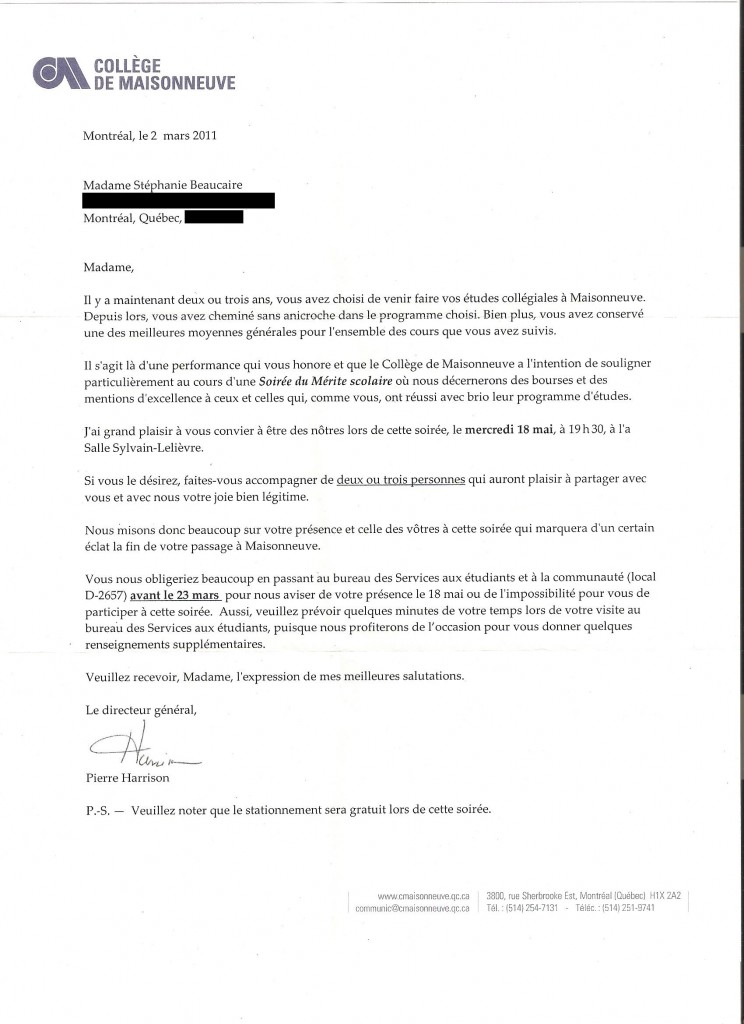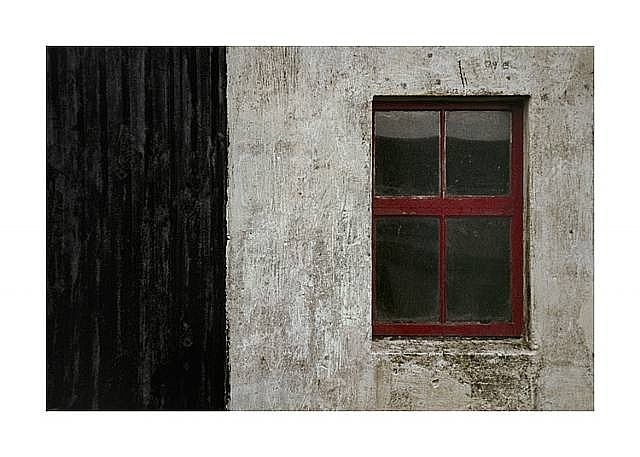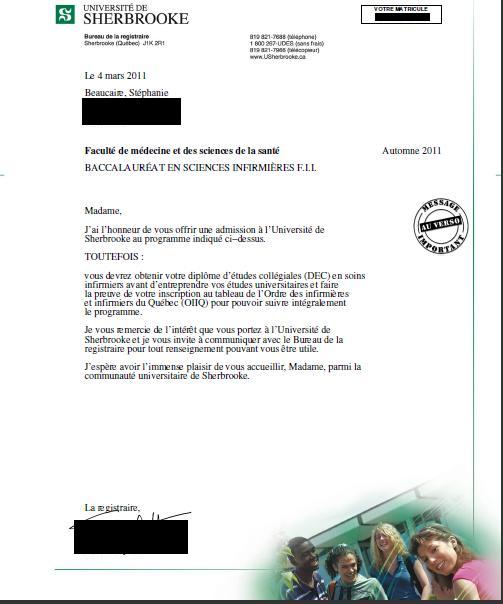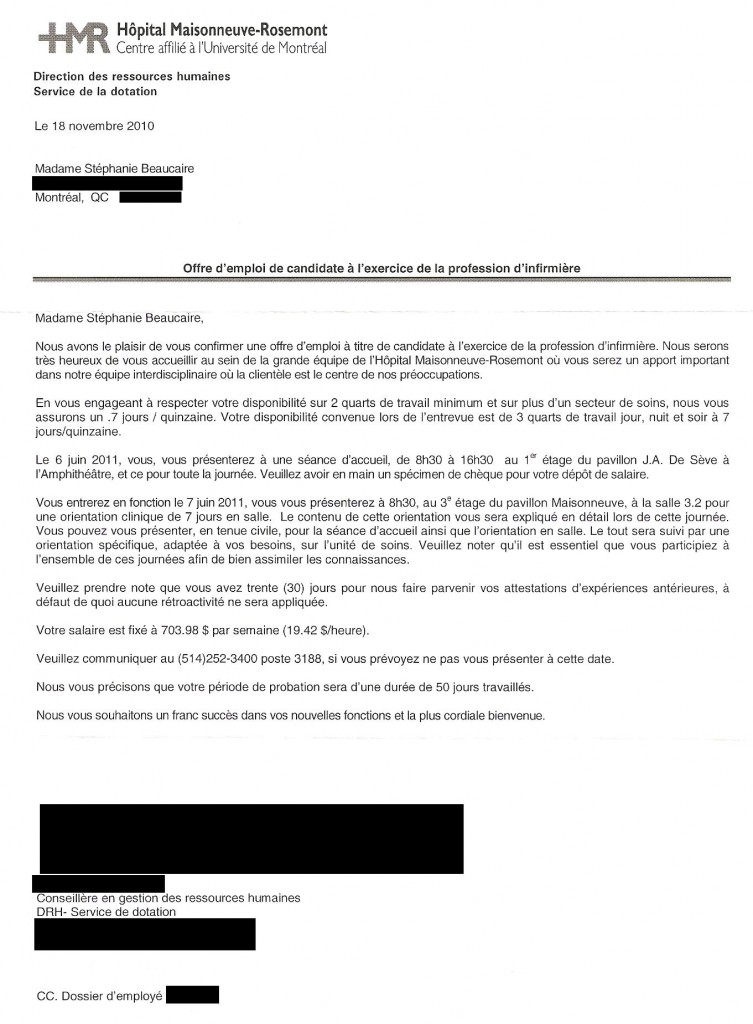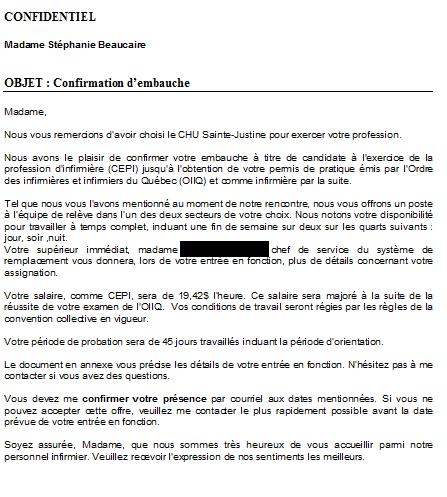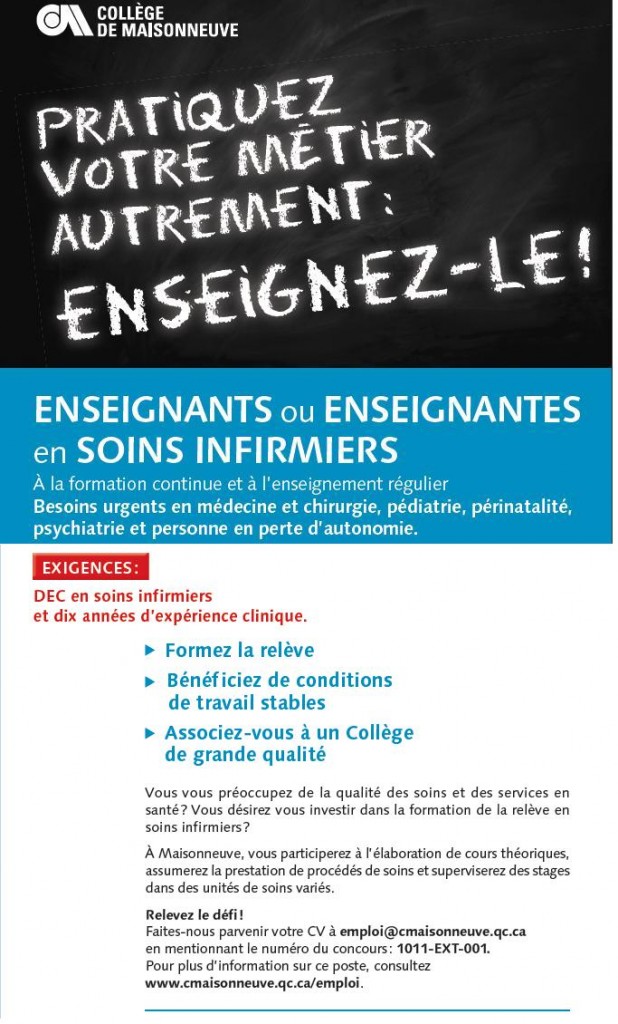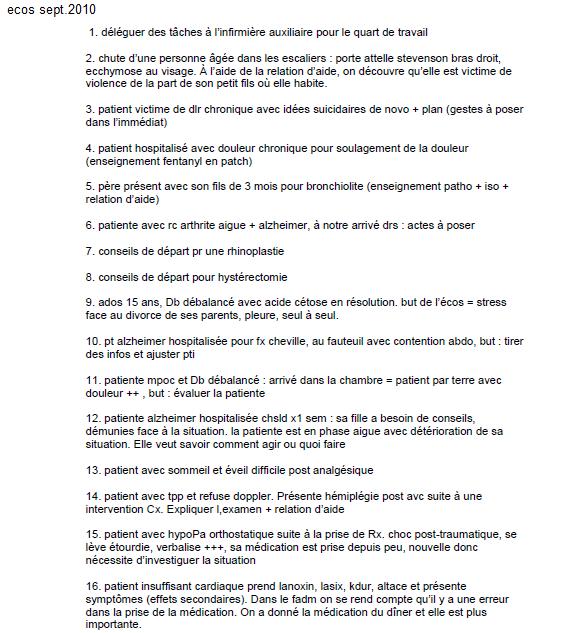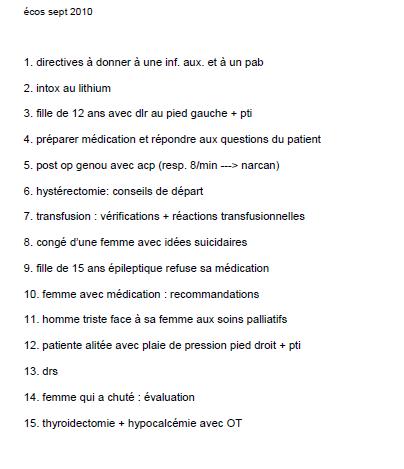Lors de notre orientation à HMR, nous avons fait la visite des salles d’opération, de sorte qu’au moment où nous y serions assignées en observation, nous aurions déjà eu le plus gros des informations. Cette visite rapide m’a laissée passablement perplexe. Toutes habillées de suit jetables en papier et avec nos masques de papier, nous tentions de faire entrer tous nos cheveux sous le petit bonnet à l’élastique éventé; en effet, l’infirmière qui nous faisait visiter avait mentionné 6 ou 7 fois qu’un seul cheveu qui vole dans l’air peut avoir des conséquences dramatiques. Or, tout le temps de la visite nous avons pu observer son toupet qui dépassait du chapeau, son maquillage outrancier incluant des brillants sur les joues, ses ongles longs et vernis et ses sandales crocs. Ce n’est pas comme si c’était extraordinaire: nous n’avons croisé personne d’autre que nous portant un masque dans la zone dite « semi-stérile » alors qu’il est sensé être obligatoire. Ce n’était pas la première fois que l’environnement hospitalier m’inspirait une réflexion dubitative au sujet des principes d’asepsie proclamés et de leur application effective.
C’était mardi dernier que se passait mon expérience d’observation en salle d’opération. La plupart de mes camarades sont revenues très excitées par cette séance. Personnellement, je me demandais ce que j’y verrais de plus que ce qu’on voit dans les documentaires scientifiques, à la télé ou encore sur les nombreux vidéos disponibles sur les sites web spécialisés ou sur youtube. Je devais me présenter au bloc opératoire à 12h30 pour assister à une hémicolectomie puis suivre le patient en salle de réveil.
Ainsi, en ce qui concerne l’opération proprement dite, je l’ai suivie sur un écran finalement, comme je l’aurais fait chez moi. Toutefois, comme je suis surtout intéressée par la découverte des milieux de travail, par les conditions dans lesquelles travaillent les soignants, médecins et infirmières, dans les différentes sphères reliées à la santé, j’ai beaucoup appris lors de cette journée d’observation car je ne connaissais rien de tout cet environnement. Je me doutais qu’il ne s’agirait pas d’un type de travail que j’aimerais faire, mais je gardais l’esprit ouvert, on ne sait jamais.
Au bout du compte, j’ai été assez frappée par la déshumanisation du travail en salle d’opération. Même si tous les efforts sont faits pour améliorer ou sauver la vie du patient, celui-ci n’est pas vraiment présent lors de l’opération, en ce sens qu’on n’a pas l’impression qu’un lien existe entre le patient qui s’est couché sur la table et le corps ouvert qui git sous les instruments du chirurgien. L’atmosphère était plus respectueuse que ce à quoi je m’attendais; la musique n’était pas trop forte (radiohead, Jack Johnson, pas pire …!) et il n’y avait pas trop de bavardage : la plupart des conversations concernaient le travail en cours ou des sujets connexes.

Yves BenDavid était le chirurgien lors de l'intervention à laquelle j'ai assisté
En ce qui a trait aux responsabilités des infirmières, le travail m’a vraiment paru être celui d’une technicienne. À la rigueur, il me semble qu’un préposé, formé de manière spécifique, pourrait exécuter le même travail, i.e. installer les instruments de manière aseptique puis les passer au chirurgien à sa demande. Même si le chirurgien de mon stage était très poli, il reste qu’il commande et l’infirmière fait ce qu’il dit. Comme il n’y a aucune surveillance clinique requise de la part des infirmières, ce travail fait peu appel au jugement et ne permet pas beaucoup d’initiative ou d’autonomie, même pas du tout d’après ce que j’ai vu. Pendant que j’assistais à l’opération, je me disais : « voilà exactement le rôle que certains médecins aimeraient sans doute voir les infirmières garder, celui d’une exécutante à leur service ». Deux secondes après que la dernière agrafe eut été installée, le chirurgien avait déjà quitté la salle avec son résident, et les infirmières couraient partout pour ramasser tous les instruments, faire le décompte, faire le ménage. Je comprends par contre qu’il peut être « reposant » en quelque sorte d’effectuer un travail plus technique, qui implique moins de responsabilité et d’organisation, faisant en sorte qu’on puisse l’exécuter d’une manière un peu plus routinière et donc moins épuisante. Plusieurs infirmières m’ont dit que celles qui vont travailler au bloc opératoire ne veulent plus retourner sur les étages … je me demande si le fait de travailler moins de soir et de nuit, et 1 fin de semaine sur 3, 4 ou 5, ne joue pas un rôle dans cette préférence, mais je n’ai pas osé poser la question!
J’ai pu observer plusieurs infirmières au travail dans la salle de réveil qui était bondée. Clairement, le côté relationnel est le laissé pour compte dans ce genre de travail. Ainsi, quand la patiente s’est éveillée et qu’elle a fait part de son soulagement au regard des appréhensions qu’elle avait eues avant la chirurgie, de la hâte qu’elle avait de se lever et de manger, quand elle a pleuré même de joie de s’être « réveillée » car elle craignait l’anesthésie, l’infirmière ne disait pas un seul mot. C’est moi au bout du compte qui ai discuté avec la patiente, tout en prenant ses signes vitaux et en mesurant les divers paramètres. À la salle de réveil, le travail est tout aussi mécanique : il s’agit, d’après ce que j’ai compris et vu, de stabiliser les patients le plus rapidement possible et surtout leur trouver une chambre afin de pouvoir libérer les lits pour les prochains opérés. Disons que les patients ont intérêt à ne pas être trop angoissés, trop inquiets ou trop bavards! Je repense à la patiente qui devra attendre plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours, avant de revoir le médecin qui lui expliquera les résultats de l’opération, de longs moments à se poser des questions, à s’inquiéter de ce qui adviendra d’elle, ce que sera la suite des événements … il m’a semblé que cette attente dans l’angoisse n’est certainement la meilleure manière de traiter les gens.
mars 21st, 2011 | Categorie: Non classé | Commentaire (4)